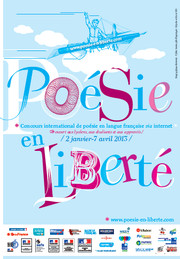| Réalisation | Denis Villeneuve |
|---|---|
| Scénario | Denis Villeneuve adapté de la pièce de Wajdi Mouawad |
| Acteurs principaux | |
| Sociétés de production | Micro Scope |
| Pays d’origine | |
| Genre | Drame |
| Sortie | 2010 |
| Durée | 130 minutes [Source : Wikipédia] |
La structure du film :
Partie 1 : Les jumeaux [Jeanne et Simon] : à la lecture du textament de leur mère, ils découvrent qu'ils ont un père et un frère encore vivants, auxquels ils sont supposés remettre une lettre. Colère de Simon. Époque actuelle.
Partie 2 : DARESH. Au pays d'origine de Nawal : séquences alternées de Nawal dont on découvre la jeunesse - l'enfant illégitime né au village et confié à un orphelinat -, l'éducation tardive, le retour sur les traces de " l'orphelin " en pleine guerre civile, si bien qu'elle ne parvient pas à le retrouver. Différence avec la pièce : dans l'une des premières séquences on nous montre les frères de Nawal tuant son amoureux Wahab (avec qui elle voulait s'enfuir). Leurs adieux déchirants et la promesse de chérir l'enfant à venir ne sont pas échangés comme dans la pièce.
Épisode sanglant du bus qui explose ; Nawal ne parvient pas à sauver une petite fille, abattue devant ses yeux. Elle n'est épargnée que parce qu'elle est chrétienne. Le pays est déchiré.
Partie 3 : Le Sud. Jeanne recherche activement son père qu'elle croit être Wahab. De retour dans le village de sa mère, elle apprend qu'elle n'est pas la bienvenue : sa famille a été frappée de la " honte ".
Partie 4 : DERESSA. Retour sur Nawal : "Je suis arrivée à la fin du massacre des réfugiés du camp de Deressa." Elle dit qu'elle veut " enseigner ce qu'elle a appris à l'ennemi."
Ellipse : elle est devenue le professeur particulier d'un enfant dans une famille aisée, protégée militairement. Elle tue le père en l'abattant presque à bout portant. Elle est alors emprisonnée dans une cellule minuscule, la fameuse cellule 72.
Partie 5 : KFAR RYAT - du nom de la prison où elle est restée quinze ans.
Jeanne visite la prison et rencontre un ancien gardien ; parlant de sa mère, il déclare : "C'est la femme qui chante (...). Elle a assassiné le chef des milices de la droite chrétienne. (...) Elle n'a jamais plié." Première évocation d'Abou Tarek, son tortionnaire ; propos tragique : "parfois il vaut mieux ne pas tout savoir." Mise en garde inopérante ! Abou Tarek "l'a brisée à répétition pour qu'elle arrête de chanter." Jeanne croit que la grossesse évoquée par le gardien - suite au viol de Nawal par son tortionnaire - explique la naissance de leur frère (paroles à Simon qu'elle tient au courant à distance).
Passé : Nawal en prison souffre.
Présent : Simon avec le notaire." J'vas chercher masoeur, c'est tout." Le notaire Jean Lebel l'accompagne : " une promesse, pour un notaire, c'set de l'ordre du sacré."
Passé (2) de Nawal au Canada : sur son lit de mort, murmurant au notaire des paroels inaudibles pour le spectateur. Puis au bureau, on le voit clore des enveloppes.
Passé de Nawal à Kfar Ryat (1) : Viol suggéré. Ellipse. Nawal enceinte. Ellipse. Accouchement. Le spectateur découvre qu'il s'agit de jumeaux. Enfants transportés de nuit à la rivière mais finalement sauvés pcq ce sont " les enfants de la femme qui chante."
Présent : Jean et Simon : arrivée au pays ; aide d'un notaire local grâce à Jean. Jeanne se rend à l'hôpital où travailel une infirmière qui a aidé sa mère à accoucher en prison. Révélation : elle a redonné ses enfants à Nawal Marwan quand elle sortie de prison. Enchaînement brutal avec la nage exutoire des jumeaux à la piscine.
Partie 6 : NIHAD. Passé (entre 1 et 2) : Courses d'enfants dans les rues pleines de décombres : enfants dégommés par u nsniper isolé qui tire du haut d'un immeuble. Mystère.
Présent : Info. recueillies sur l'enfant abandonné à l'orphelinat de Kfar Kout : Nihad. Pas d'adoption. Sur ses traces... : cheminement des enfants qui marchent sur les pas de leur frère et de leur mère.Chef de guerre qui a détruit cet orphelinat : Chamseddine, toujours vivant. Ils vont au camp de Deressa afin de trouver "Nihad de Mai ", fils de "la femme qui chante ". reprise notable de ces expressions de Wajdi Mouawad, qui contribuent à la force lyrique de l'oeuvre.
Passé (1) : Nawal dans une voiture. Un homme parle : " Tu as besoin d'aide. (...) Je serai toujours là pour toi et tes enfants."
Partie 7 : CHAMSEDDINE
Rendez-vous fixé à Simon qui doit s'y rendre les yeux bandés. Chamseddine a bien connu Nawal qui a travaillé pour lui. Tête à tête des deux hommes. À propos de l'orphelinat : "J'ai épargné les enfants (...) Nihad était parmi eux. (...) à part (...) un tireur redoutable (...) Devenu un fou de guerre, devenu franc-tireur, le plus dangereux de la région. " Fait prisonnier, il a été formé et est devenu un bourreau dans le camp des chrétiens. L'entretien se poursuit.
Séquence : Simon et Jeanne : 1+1 = 1
Passé (2) Nawal à la piscine, quelques années avant sa mort : elle reconnaît son bourreau comme étant également son fils : il porte les marques que la grand-mère de Nawal lui avait faites au pied. Diiférence avec le livre dans le mode d'identification du fils ; il n'est pas question de procès ici, comme si le bourreau avait pu continuer à vivre en toute impunité. Plongée dans le silence dont elle ne sortira que sur son lit de mort pour donner ses instructions testamentaires.
Présent : retour sur la révélation de Chamseddine : Nihad de Mai est Abou Tarek. Il vit au Canada sous une nouvelle identité (la boucle est bouclée !).
Jeanne et Simon retrouvent Nihad et lui remettent les lettres
Jeanne et Simon chez le notaire prennent connaissance d'une lettre qui leur est adressée : la Lettre aux jumeaux. Une promesse : celle de " briser le fil de la colère " (dans la pièce de théâtre c'est une promesse que Nawal fait à sa grand-mère en acceptant d'être instruite). Leitmotiv de la pièce exprimé : " Rien n'est plus beau que d'être ensemble."
Jeanne et Simon chez le notaire prennent connaissance d'une lettre qui leur est adressée : la Lettre aux jumeaux. Une promesse : celle de " briser le fil de la colère " (dans la pièce de théâtre c'est une promesse que Nawal fait à sa grand-mère en acceptant d'être instruite). Leitmotiv de la pièce exprimé : " Rien n'est plus beau que d'être ensemble."
Séquence finale : le cimetière ; l'inscription sur la pierre ; acte final qui signifie le repos de Nawal et la réconciliation des générations.
Les promesses ont été tenues !